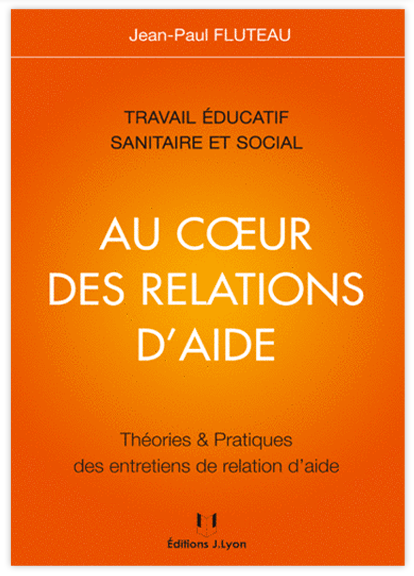Après "L’Enfant Gigogne" et son succès remporté, aussi bien auprès du grand public que des professionnels, Jean-Paul Fluteau s’adresse, avec ce nouvel ouvrage, exclusivement aux professionnels de la relation d’aide et de la psychothérapie. Il nous offre un véritable manuel didactique de référence qui alterne théorie, pratique, illustrations et vécus de terrains.
Grâce à sa connaissance détaillée de ces différents milieux professionnels, il propose :
- un diagnostic des pratiques et des mentalités qui les accompagnent. Les failles des pratiques courantes avec leurs lots de préjugés et d’idées reçues sont clairement mises en évidence.
- des techniques et des méthodologies rigoureuses adaptées aux réalités de terrains sont proposées avec les références théoriques et conceptuelles qui les étayent, ainsi que des modèles et des concepts originaux issus de ses propres recherches.
- des réponses concrètes à des questions pratiques :
Comment démarrer une prise en charge, une mesure, une intervention ?
Comment structurer et organiser les entretiens ?
Comment aller à l’essentiel sans être noyé par des détails inutiles ?
Comment passer du problème à la solution ?
Comment savoir jusqu’où aller ? la frontière entre un travail éducatif ou social et un travail thérapeutique ?
Comment gérer des mesures judiciaires ?
Comment intervenir dans les cas de suspicions d’enfants en danger ?
Comment répondre à des demandes d’aide financière ?
Comment travailler avec les parents d’enfants accueillis en institution ?
Comment mener des entretiens au domicile des personnes ?
Comment gérer l’agressivité des personnes ?
Comment gérer ses propres émotions face aux personnes ?
Comment se positionner par rapport à la confidentialité, au secret professionnel et aux obligations légales ?
Et plus encore... Des réponses à des questions qui ne se posent pas !
Vouloir aider les personnes en difficulté constitue manifestement une valeur et un objectif moralement élevés, d’une grande noblesse et qui semble par ailleurs être une motivation fondamentalement indispensable pour s’engager dans ces différentes professions des secteurs éducatifs, sanitaires et sociaux. Cependant, les bonnes intentions, si elles sont nécessaires, sont-elles suffisantes ? Le monde du travail éducatif, sanitaire et social n’est-il pas, comme l’enfer, pavé de bonnes intentions ? Les moyens mis en oeuvre pour aider sont-ils adaptés, pertinents, efficaces, écologiques, génèrent-ils des effets iatrogènes, sont-ils à l’origine de problèmes supplémentaires aux problèmes initiaux des personnes ? Si l’on se réfère aux constats précédents – ne serait-ce que sur les capacités des professionnels à mettre en oeuvre des communications professionnelles saines – on est en droit de s’interroger. Au delà de ces premières interrogations, il me semble par ailleurs très important d’aller explorer tout ce qu’implique l’aide, tout ce qui en découle. Identifions les implications de la démarche d’aide.
Si l’on est amené à aider une personne, c’est que cette personne est confrontée à un problème, une difficulté, une limite.
Qui dit aide, dit donc problème.
Si l’on intervient à propos de ce problème ou de cette difficulté, c’est manifestement pour aider à sa résolution, et non pas pour « aider » à son aggravation !
Qui dit problème, dit donc résolution.
Donc, si l’on aide à propos de problèmes pour les résoudre, quelle réalité humaine cela concerne t-il ? À quelle réalité humaine se réfère-t-on implicitement et qui doit nécessairement exister pour que cette affirmation ait un sens, autrement dit quel est le présupposé contenu dans cette affirmation ? Comme bien souvent, lorsque la réponse est tellement simple et évidente, il est souvent difficile de la trouver.
Aider à propos de problèmes pour les résoudre, concerne :
la capacité de l’être humain à changer.
Changer sa façon de penser, de faire, de fonctionner, quelle que soit la nature du problème, cela concerne donc : le changement humain.
Une question fondamentale se pose alors : Quelles sont les conditions pour qu’un être humain change (sa façon de penser, de fonctionner, de faire) ?
Depuis que le travail éducatif, sanitaire et social s’est professionnalisé au lendemain de la seconde guerre mondiale, des milliers de professionnels sont sortis des écoles et instituts de formations avec le désir et l’objectif d’aider des personnes en difficulté, objectif qui, pour sa réalisation, est donc en lien avec les conditions requises pour qu’un être humain change.
Alors quand je pose, toujours à ces mêmes professionnels qui veulent aider, la question :
« Combien d’heures d’enseignement vous ont été proposées pour apprendre quelles sont les conditions pour qu’une personne change ? » (Ce qui semblerait logique quand on a pour objectif d’aider des personnes en difficulté !).
J’ai toujours la même réponse : « Aucun enseignement ne nous a été proposé à ce sujet. »
Comment se fait-il que la question des conditions requises pour qu’une personne change ne soit pas posée, ne soit pas travaillée de façon explicite au cours des formations initiales, alors que cet apprentissage apparaît manifestement aussi fondamental que l’est, pour un mécanicien, le fait de connaître le fonctionnement des moteurs sur lesquels il est amené à intervenir ? Qu’en serait-il de l’efficacité des mécaniciens s’ils n’avaient aucune connaissance du fonctionnement d’un moteur ? De fait, les différents travailleurs sociaux se retrouvent justement dans cette situation.
La relation d’aide exige la connaissance des conditions requises pour qu’une personne change ; les travailleurs sociaux veulent aider alors qu’ils n’ont pas de connaissances objectivées et explicitées sur cette question. Comment se fait-il donc que l’on ne se soit pas posé cette question dans le contexte des formations initiales ? Comme pour la question du travail d’apprentissage de la communication qui n’est pas proposé parce que l’on considère implicitement que les personnes qui s’engagent dans les formations initiales savent communiquer, il me semble que si l’on ne se pose pas la question de savoir quelles sont les conditions nécessaires pour qu’une personne change, c’est que la réponse paraît implicitement évidente à la majorité des acteurs concernés. Cette réponse implicite, aux conséquences énormes sur le terrain, est :
« Il suffit qu’un professionnel compétent le veuille et le décide, pour qu’une personne change. »
Toutes les pratiques sur le terrain sont induites par cette référence implicite, toutes les orientations et les demandes politiques, administratives, exercées sur les travailleurs sociaux, reposent et sont influencées par cette référence. Cette référence implicite n’a bien sûr de sens et d’influence que si elle reste à l’état implicite car son explicitation révèle automatiquement son aberration, son caractère erroné, même au regard du néophyte, pour peu qu’il ait un peu de bon sens !
Que les travailleurs sociaux mettent en oeuvre des moyens pour faire changer des personnes qui, très souvent ne leur ont, à aucun moment, demandé de l’aide et qui n’ont même pas conscience de l’intérêt pour elles-mêmes de changer leur façon de vivre ou de faire, est bien la résultante de cette référence implicite.
Que des élus attendent des travailleurs sociaux qu’ils interviennent et qu’ils leurs demandent d’intervenir auprès de personnes qui n’ont rien demandé, en attendant de ces interventions des changements chez ces personnes, est bien la résultante de cette référence implicite.
Que les travailleurs sociaux ne se positionnent pas en expliquant aux autorités qu’ils n’ont pas le pouvoir de faire changer les personnes malgré elles, si elles ne réclament pas une aide, est bien la résultante de cette référence implicite.
Que les travailleurs sociaux n’expliquent pas aux autorités que, lorsque les personnes ne veulent pas de leurs interventions et qu’elles ne transgressent pas par ailleurs la loi, ils ne peuvent rien faire d’autre que de proposer leur aide et ne peuvent rien faire de plus, si les personnes persistent à ne pas en vouloir, met bien encore en évidence la présence de cette référence implicite chez tous ces acteurs des secteurs éducatifs, sanitaires et sociaux.
S’il me semble logique que les non professionnels, élus, administratifs, médias, etc. fonctionnent avec une vision erronée des conditions requises pour qu’une personne change, (ce ne sont pas eux les spécialistes !), il me semble très problématique que les professionnels fonctionnent avec cette même référence béotienne, erronée et se laissent dicter leurs orientations techniques et méthodologiques par des non professionnels de leur discipline, les élus et administratifs qui n’ont de légitimité que sur le plan de la détermination des objectifs, des orientations, mais pas sur le plan des moyens techniques et méthodologiques à mettre en oeuvre. Ce point pose la question fondamentale de l’autonomie technique des travailleurs sociaux qui est un élément fondamental de leurs codes déontologiques professionnels, codes déontologiques qui semblent être de moins en moins présents à leur conscience !